Chandeleur
2 février
2 février
|
Chandeleur
2 février |
| des chandelles à la Chandeleur | ||||

|
La chandeleur se fête le 2 février. Ce nom vient de
l'expression festa candelarum : la fête
des chandelles. Le latin candela
désigne une bougie : il a donné en français la
chandelle qui s'est effacée devant la
bougie, d'origine algérienne. Bougie
est en effet le nom d'une ville de Kabylie (Algérie), en arabe
Bejaïa, qui fournissait au moyen-âge de
la cire pour fabriquer des chandelles. Mais au Québec, la chandelle
est toujours vivante !
Cependant, dans la fête des chandelles, il est plutôt question de cierges que de chandelles ! Ce sont des cierges portés en procession qui ont donné le nom à la fête. C'est très certainement, comme Noël, la récupération d'une coutume préchrétienne. La Chandeleur a lieu 40 jours après Noël : on l'a fait coincider avec la purification de la mère de Jésus et la présentation du nouveau-né au temple. Selon la loi juive de cette époque (Lévitique, XII), une mère qui accouche d'un garçon était considérée comme impure pendant 7 jours et devait ensuite attendre la purification de son sang pendant 33 jours (donc pas question de se rendre dans un lieu sacré pendant cette période ! ). Pour une fille, les délais étaient plus longs : la mère était impure pendant 14 jours et la purification avait lieu au bout de 66 jours ! La circoncision du garçon avait lieu le 8e jour. La circonsion de Jésus se fête donc le 8e jour après Noël, c'est à dire le jour de l'an ! Cette célébration est aujourd'hui tombée en désuétude... et plus personne ne pense à fêter la circoncision du petit Jésus ce jour-là ! A propos du comptage des jours, il faut savoir que dans l'Antiquité, on comptait le premier jour (aujourd'hui, si on parle du 8e jour, il tomberait le 2 janvier ! ). Jésus est mort un vendredi et ressuscité le troisième jour qui tombe.. un dimanche ! et non le lundi de Pâques ! |
|||
|
Aujourd'hui, la Chandeleur évoque plutôt les crêpes que
les cierges : c'est la fête des crêpes ! Et pourquoi ne pas faire de
la Chandeleur, un repas de crêpes aux chandelles ?
En Bretagne, la crêpe porte le nom de krampouezh [-poué] et un krampoueshour [-sour], c'est un amateur de crêpes. En Corse, les nicci désignent des crêpes à base de pisticcina (farine de châtaigne) : mettez un peu de pisticcina dans vos crêpes : c'est un régal ! (environ 1/4 de farine de châtaigne et 3/4 de farine de blé) Des crêpes, du cidre et des chandelles... et vive la Chandeleur ! A Marseille, on fête la Candélouse ! (en provençal : Candelouso) et on mange des navettes de Saint-Victor (naveto de Sant-Vitou) petites pâtisseries en forme de barque... |
||||
 |
recettes de crêpes | |||
|
en
italien : Candelora (candela =
bougie)
en espagnol : Candelaria en anglais : Candlemas (candle = bougie) le suffixe -mas est le même que pour Christmas : c'est la messe (bénédiction) des bougies en allemand : Lichtmeß (Mariä Lichtmeß) (Licht = lumière) le suffixe -meß a la même origine que l'anglais |
||||
|
Joyeuse Chandeleur ! Buona Candelora !
Happy Candlemas ! Fröhliche Lichtmeß !
|
||||
| La fête des marmottes | ||||
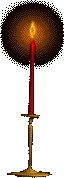
|
En Amérique, on ne fête pas la Chandeleur : le 2
février, c'est le Groundhog Day : le
jour de nouvel an des marmottes ! C'est la fin de l'hiver et de
l'hibernation.
groundhog vient de ground (terre) et hog désigne le cochon ! Ce mot est d'origine celtique et apparenté au gallois hwch, (cf. breton hoc'h : porc) de même sens. C'est un synonyme de woodchuck : ce terme est une adaptation anglaise d'un mot indien. Ce nom n'a donc rien à voir avec un quelconque animal des bois tel que le woodcock (coq des bois ou bécasse). En français, nous l'appelons la marmotte d'Amérique dont le nom latin est marmota monax. Elle vit en Alaska, au Canada et au nord-est des Etats-Unis. Selon un dicton populaire, le temps du 2 février indique la fin de l'hiver : si le jour est nuageux, alors le printemps sera précoce ; si le jour est ensoleillé, alors l'hiver durera encore six semaines ! D'où cette légende : une marmotte qui sort de son terrier le 2 février retourne hiberner si elle voit son ombre ! La marmotte commence à hiberner en octobre et sort de son sommeil hivernal à partir de la fin mars... et non le 2 février ! L'hibernation dure environ 6 mois. En fait, cette légende a été importée d'Europe par les premiers colons qui ont remplacé l'ours par la marmotte ! Même si la marmotte d'Amérique est plus grasse que la marmotte des Alpes, elle est cependant loin d'atteindre la taille d'un ours ! |
|||
| Proverbes et dictons | ||||
| le dicton du jour :
à la Chandeleur, l’hiver se meurt ou prend
vigueur
|
||||
| proverbe
provençal :
A la Candelouso, l'ourse fai tres saut
Foro de soun trau : S'es nivo, s'envai ; Se fai soulèu, intro mai E sort plus de quaranto jour.
Frédéric Mistral, lou Tresor dóu Felibrige
A la Candélouse (Chandeleur), l'ours fait trois sauts hors de son trou : s'il neige, il s'en va ; s'il fait soleil, il rentre et ne sort plus pendant quarante jours. |
||||
|
L'ours et l'homme, c'est un peu une histoire de famille.
L'ours est l'un des rares animaux plantigrades... comme l'homme et,
d'une certaine façon... la marmotte. L'ours, c'est l'homme sauvage.
Autrefois, l'un et l'autre rencontraient des difficultés à se
nourrir l'hiver. C'est pour cette raison, que l'ours et la marmotte,
hibernent. En évitant de bouger et d'être en contact avec le froid,
ces animaux dépensent très peu de calories.
Le réveil de l'ours était le signe du retour du printemps. Il était fêté dans toute l'Europe, des Pyrénées au Carpates. Les hommes se déguisaient alors en ours : cette tradition se confond aujourd'hui avec le mardi gras... |
||||
| proverbe
lorrain : en Lorraine, il ne s'agit pas seulement de l'ours mais
aussi du loup, comme à Courbesseaux (recueilli en 1881) :
Ès Chandôles, quand lo slo béille,
lo loup enteure dans sè grotte pou hheille semaines ; quand i n'béille-me, c'ast pou quarante jonées A la Chandôles, quand le soleil brille, le loup rentre dans sa grotte pour six semaines ; quand il ne brille pas, c'est pour quarante jours. |
||||
 |
le site officiel du Punxsutawney Groundhog Club | |||
 |
marmotte d'Amérique | |||
 |
images animées de marmottes... de quoi souhaiter un Happy Groundhog Day à tous vos amis ! | |||
 |
étymologie de la marmotte | |||
| Imbolc, la fête du printemps. | ||||
| Ces traditions liées aux chandelles et à
l'ours sont préchrétiennes. Comme la fête de Noël, ces fêtes ont été
revues et corrigées par l'église catholique. Ces traditions
correspondent à la fin de l'hiver et à l'avènement du printemps. Dans l'Antiquité, le printemps commençait début février. Les solstices et les équinoxes marquent aujourd'hui le début des saisons, mais autrefois ils correspondaient au milieu des saisons : il y a donc un décalage de 8 semaines par rapport aux saisons actuelles. Dans les pays celtiques, c'est la fête d'Imbolc. Si on prend comme référence la date du 21 pour le solstice ou l'équinoxe, il faut retirer 15 jours pour avoir la date du début de la saison des gaulois et des romains. Ainsi, le printemps commençait autrefois autour du 6 février. Arbitrairement, on a fixé le début de la saison celtique le 1er du mois : Imbuc se fête alors le 1er février. Le 1er février, c'est aussi la sainte Brigitte : Lá Fhéile Bríde (en gaélique). Brigitte est à l'origine le nom de la grande (et presque unique) déesse du panthéon celtique. On a gardé le prénom et l'église catholique célèbre ce jour-là une vulgaire sainte irlandaise qu'elle a baptisé du nom de Brigitte... |
||||
 |
Noël - Épiphanie - Carême - Pâques - Ascension - Pentecôte | |||
 |
printemps | |||
 |
calendriers | |||
 |
étymologie | |||